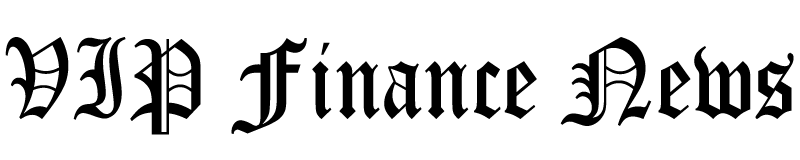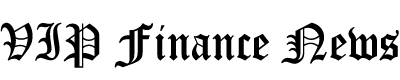Les États membres de l’Union européenne devaient se prononcer le 13 octobre à Bruxelles sur la prolongation du glyphostage – ce produit chimique que l’on retrouve dans des herbicides – pour 10 ans, mais n’ont pas réussi à s’accorder : la décision est repoussée à mi-novembre. Un épisode qui vient rappeler la prévalence du lobbyisme au sein des institutions européennes, sur fond de controverse scientifique quant aux effets sanitaires de la molécule prisée des industriels de l’agrochimie.
Entretien avec Sylvain Laurens, directeur d’études à l’EHESS et chercheur au Centre Maurice Halbwachs (ENS/CNRS/EHESS). Fin connaisseur des logiques d’influence à Bruxelles et des mécaniques de désinformation scientifique, le sociologue a notamment écrit Les courtiers du capitalisme. Lobbyists and Bureaucrats in Brussels, et a récemment cosigné Les gardiens de la raison aux côtés des journalistes Stéphane Foucart et Stéphane Horel.
Le glyphosate est de nouveau sous le feu des projecteurs. En 2017, il avait déjà été prolongé pour une durée de cinq ans. Qu’est-ce qui a changé depuis ?
La vraie évolution depuis 2017, c’est le degré de médiatisation de ces enjeux, le degré de connaissance de l’opinion publique sur les effets du glyphosate. Du fait de ces évolutions, on a assisté à une évolution des positions officielles – au moins sur la forme – et on a pu voir se matérialiser une prise de conscience des gouvernements, en témoignent les réserves exprimées par la France ou par l’Allemagne sur le dossier.
En fait, c’est une forme de jeu institutionnel, car ces États tablent probablement sur le fait que la Commission pourra proposer une durée de prolongation plus courte, par exemple de cinq ans. Le fond du problème, c’est que les États n’ont actuellement aucune stratégie de sortie du glyphosate pour les agriculteurs. On est dans une forme de statu quo car rien n’a été fait pour accompagner le changement au niveau de la filière.
En 2017, la bataille de l’opinion avait principalement été menée par des ONG. En 2023, on note que beaucoup de citoyens ont également pris le relais. Mais cette plus grande médiatisation et cette diffusion plus grande des enjeux ne signifient pas pour autant une inflexion sur le fond, car les résistances économiques sont grandes : le glyphosate est la clé de voûte de tout un système agrochimique, dont dépend le modèle agricole dominant tant pour l’agriculture que pour l’élevage. Bifurquer vers un monde sans glyphosate supposerait de repenser la structuration de la filière agro-alimentaire. C’est un vrai travail de fond qui supposerait d’aller à la fois contre des intérêts économiques et un mode d’organisation de la filière agricole qui prévaut au moins depuis l’après-guerre.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Autre changement depuis 2017, les critiques portées par les scientifiques dans l’espace public ne se limitent pas à la cancerogénéité, mais couvrent tous les effets possibles du glyphosate sur l’organisme. C’est aussi cela que montre la récente médiatisation d’une décision de justice qui suggère un lien entre l’exposition à l’herbicide pendant la grossesse et la survenue de malformations graves chez l’enfant. Longtemps, le débat scientifique sur le glyphosate ne s’est intéressé qu’à ses effets potentiellement cancérogènes, en témoigne l’affaire Dewayne Johnson, qui avait mis les États-Unis en émoi en 2018 et abouti à la condamnation de Monsanto et à la mise en ligne des Monsanto Papers offrant un aperçu des méthodes utilisées par la firme pour embrouiller le débat scientifique. Le débat est aujourd’hui bien plus large : il s’intéresse par exemple aux effets neurologiques de la molécule.
Cela ne veut pas dire que l’on sait tout, mais que les chaînes de causalité se sont au moins éclaircies depuis 2017. On dispose d’éléments supplémentaires qui augmentent le coût social à reconduire ce produit, ce qui ne veut pas dire que les décisions à venir seront rapides ou iront dans le sens d’un abandon immédiat du produit.
Quels parallèles peut-on tracer avec les autres controverses scientifiques où la science va à rebours des intérêts industriels, comme l’emblématique « fabrique du doute » des industries du tabac ?
Si je devais faire un parallèle, ce serait plutôt avec l’amiante qu’avec le tabac. Entre le moment de l’établissement d’un consensus scientifique, la prise de conscience par les pouvoirs publics et l’abandon de ce matériau dans la construction et le lancement des plans de désamiantage, il s’est passé plusieurs années. L’abandon suppose une bifurcation économique que l’État peut accompagner en investissant mais il y a un temps de latence entre la prise de conscience des gouvernements et la limitation des usages de la substance.
Mais le point commun de ces controverses, que ce soit sur le tabac, l’amiante ou le glyphosate, réside généralement dans la prétention des industriels ou groupes d’intérêt à parler au nom de la science. Cet enjeu est évidemment très présent pour le glyphosate : une seule institution internationale, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’ONU, a émis une prise de position en défaveur de la molécule, le classant dans la catégorie des « cancérogènes probables ». Mais c’est une agence qui prend en compte une littérature scientifique qui n’est pas financée par les industriels, là où d’autres agences, comme celles de l’UE, prennent en compte également les publications produites par les industriels ou leurs alliés, avec des papiers parfois signés par des scientifiques, mais rédigés par des experts des firmes : les Monsanto Papers regorgent ainsi de « shadow writing ». Pour ces industriels, il en va de la pérennité de la commercialisation de leurs produits. Il faut donc à la fois instiller du doute, mais aussi éviter toute remise en cause de l’organisation de la filière économique qui permet l’écoulement de leur produit.
C’est peut-être sur ce point que l’expression « fabrique du doute » est un peu trop limitée. Il est, à mon avis, plus intéressant d’analyser les levées de boucliers autour du glyphosate au prisme de ce que les chercheurs Aaron McCright et Riley Dunlap appellent des mouvements anti-réflexifs. Il ne s’agit pas seulement de brouiller l’état du consensus scientifique aux yeux des décideurs, mais plus largement de priver la société des formidables outils de réflexivité qu’offre la science. Cela pose un problème beaucoup plus grave. L’opinion publique consent à financer par l’impôt la recherche et l’effort scientifique pour pouvoir aussi mieux appréhender les chaînes de causalité dans lesquelles nos sociétés sont entraînées. En nous privant de l’accès à la réflexivité offerte par la science, on prive la société d’une capacité à envisager des changements profonds face aux impasses prises sur certains plans par notre appareil de production. Les démonstrations de McCright et Dunlap valent à mon sens aussi bien pour le climat que pour le glyphosate.
Comment s’est déroulée la procédure qui a mené à la demande de prolongation ?Quels sont les différents acteurs politiques et réglementaires qui interviennent ?
En 2017, les États membres de l’UE s’étaient accordés sur une prolongation de cinq ans. En amont de cette décision, les industriels s’étaient regroupées en une Glyphosate Task Force, qui est devenue par la suite devenue le Glyphosate Renewal Group. Le financement de ce lobby est assez transparent et on y retrouve logiquement les fabricants de pesticides qui ont intérêt à maintenir le glyphosate sur le marché. On trouve dans la liste des financeurs Bayer, Syngenta mais aussi Albaugh Europe, Barclay Chemicals, Ciech Sarzyna, Industrias Afrasa, Nufarm, Sinon Corporation, etc.
Ces industriels ont regroupé les études qui vont dans leur sens ainsi que les revues de littérature qui à leurs yeux prouvent la non-dangerosité du produit. Et ils ont officiellement demandé le renouvellement du produit.
La procédure classique, dans ce cas-là, est de confier la lecture et la synthèse de ces études d’impact à un État membre. Ici, au vu de la difficulté du sujet, cette tâche a été confiée en mai 2019 à quatre États membres différents (la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède. Ce groupement appelé « Assessment Group of Glyphosate » a seulement exclu deux études soumises par les industriels et a produit un rapport de synthèse qui reprend les mots d’ordre de l’industrie préconisant des restrictions uniquement pour certains usages du glyphosate.
Le rapport a été remis, conformément à la procédure, à deux agences réglementaires européennes : l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui ont jugé, à partir de celui-ci, qu’aucun obstacle ne s’opposait à un renouvellement. Logiquement la commission a donc proposé en septembre 2023 une première proposition de texte pour renouveler le produit. Il s’agit d’une procédure de renouvellement. Elle peut passer en « comitology », selon le jargon bruxellois, et donc être décidée dans un huis clos bureaucratique associant fonctionnaires de la Commission et représentants des États membres.
Le principal problème est que l’ECHA travaille surtout sur la base des données transmises par les industriels. Ce mode de fonctionnement est lié à la réglementation européenne REACH qui a externalisé la charge de la preuve de l’innocuité des produits aux industriels. Ce processus a été très bien décrit dans les travaux d’Henri Bouiller. À l’époque, c’était perçu comme un progrès de demander aux industriels de prouver que leurs produits n’étaient pas dangereux, mais on n’a pas suffisamment anticipé le fait qu’il faudrait que ces agences aient leur propre capacité d’investigation sur des sujets tels que le glyphosate et ne se contentent pas de relire les documents soumis par l’industrie.
Le fond du problème est-il donc un problème de « design » des institutions européennes qui ouvre la voie au lobbyisme ?
Il y a une ambivalence fondamentale jusqu’à l’organigramme de ces agences : l’ECHA, par exemple, a pour double tutelle à sa création la DG Entreprises et la DG environnement, et doit ainsi concilier enjeux économiques et expertise scientifique. Les choses évoluent peu à peu mais des agences comme l’EFSA donnent encore une place centrale à des panels d’experts dont on ne cesse d’essayer de limiter les liens avec l’industrie. Il faudrait effectivement repenser le fonctionnement des institutions européennes de façon à donner une voix aux scientifiques de façon structurelle et pas seulement en nommant « un conseiller scientifique » auprès du président de la Commission européenne.
La transformation en scandales des cas graves d’atteinte aux personnes en raison du glyphosate peuvent être des stratégies payantes pour mobiliser l’opinion, mais le débouché de ces campagnes peine à se concrétiser sur le plan réglementaire, car les agences rattachées à la Commission ont initialement été pensées pour réglementer a minima la mise en circulation des marchandises dans un marché commun. Leur demander de réviser le fonctionnement d’une filière agro-industrielle n’est absolument pas dans leur prérogative. L’histoire des institutions européennes est en effet liée à la mise en place d’un marché commun, et à la nécessité de mettre un cadre permettant la libre circulation des marchandises. Pour changer les choses, il faudrait en passer par des réformes complexes des institutions européennes, mais il n’est pas certain que le contexte politique actuel le permette, sur fond de Brexit et de relations tendues avec la Hongrie et la montée des illibéralismes.
Christian Lue, CC BY
Si on ajoute tous ces éléments, il n’y a pas besoin de théorie du complot pour expliquer l’arrivée sur la table de cette proposition sur le glyphosate et la prévalence du lobbyisme à Bruxelles. Porter ses positions industrielles au nom de la science à travers un groupe d’intérêt, toutes les grosses entreprises le font. Et le Glyphosate Renewal Group n’est qu’une des 1200 business associations qui œuvrent à Bruxelles. Et du côté des institutions, ces agences font précisément ce pour quoi elles ont été mandatées : accompagner la commercialisation de produits en s’assurant que les industriels sont capables de remplir des dossiers prouvant que leur produit n’est pas si dangereux si on respecte certaines normes d’exposition.
Ce n’est pas de la science, c’est au mieux de la science réglementaire. Les scientifiques n’ont pas accès aux jeux de données de toutes ces études transmises par l’industrie (protégées pour partie par le secret industriel). Et même quand Bayer annonce qu’il va donner toute transparence aux publications transmises ou financées, on n’a pas accès aux jeux de données brutes, mais au mieux aux abstracts – cette limitation à l’accès des données était encore plus caricaturale en 2017, Stéphane Horel décrivant par exemple la mise à disposition de données par l’industrie sur un ordinateur fixe, dans une salle avec horaires restrictifs et sans possibilité de faire de copies numériques.
Ici, on est sur de la science entravée dans ses principes de libre communication des données et on ne peut pas s’assurer de la réplicabilité de ces études : c’est une distorsion de ce qu’est vraiment la science. Entre cette « science réglementaire » et la science tout court, il y a donc un interstice, une faille que les industriels se plaisent à occuper et que les pouvoirs publics peinent à colmater. Les décisions de l’Union européenne ne sont en réalité pas toujours « Evidence Based » sur des sujets comme le glyphosate. S’il y a un intérêt intellectuel à travailler sur ces sujets, c’est aussi, car le glyphosate est l’un des rares dossiers où il existe une telle distorsion entre la « science réglementaire » et la science tout court.
Credit: Source link